Opinions
Managers à temps partagé, des accélérateurs pour la croissance de l’entreprise
24 octobre 2025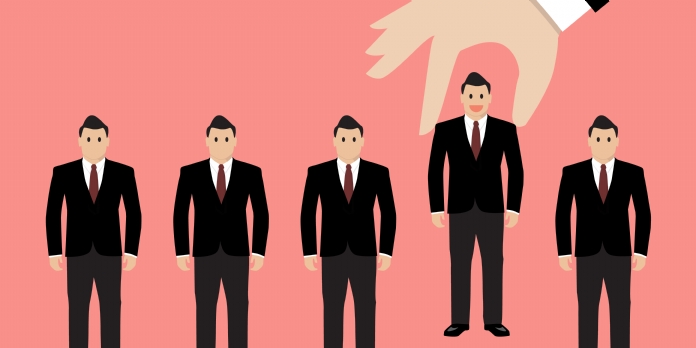 A raison de quelques jours/homme par mois, les dirigeants d’entreprises peuvent s’entourer de professionnels de très bon niveau pour les accompagner, développer et mettre en oeuvre leur stratégie marketing.
A raison de quelques jours/homme par mois, les dirigeants d’entreprises peuvent s’entourer de professionnels de très bon niveau pour les accompagner, développer et mettre en oeuvre leur stratégie marketing.
Une solution souple et financièrement accessible qui offre beaucoup d’avantages.
Car embaucher un directeur marketing aguerri coûte… .
Plus de 80k€ annuels pour recruter un professionnel expérimenté, ce qui n’est pas à la portée de toutes les entreprises.
Un directeur marketing à temps partagé interviendra un à trois jours par semaine, sur une durée déterminée pour aider un dirigeant à accélérer son business, réagir face à une baisse de son activité, voire anticiper une évolution de son marché.
Avec de nombreux avantages : une disponibilité immédiate, l’assurance de bénéficier de compétences solides, la possibilité d’interrompre cette collaboration une fois les besoins satisfaits ou bien d’espacer les interventions dans le temps… . Une formule très souple qui peut revêtir plusieurs formes : recruter un directeur marketing à temps partiel, faire appel à une agence qui facturera les prestations ou encore recourir aux services d’un indépendant.
Pour un coût qui reste très raisonnable compte tenu de la contribution au résultat de l’entreprise : 5 à 6 k€ net par mois pour l’intervention d’un professionnel un jour par semaine.
Au delà de la question du coût, les dirigeants apprécient tout particulièrement de pouvoir disposer d’un professionnel quand ils en ont besoin et au niveau d’intervention dont ils ont besoin. Le chantier commence souvent par un travail de fond, une sorte de mise à plat qui débouche sur un plan marketing stratégique. Le manager accompagnera l’entreprise sur une étude de marché, interviendra sur la signature de la marque, le logo, les packagings,… . Il travaillera sur les contenus de marque et la communication digitale… . Il pourra même mettre en place une petite équipe marketing en s’appuyant sur les compétences existantes dans l’entreprise… .
En matière d’organisation, les dirigeants apprécient également de pouvoir s’entourer ponctuellement de compétences, qui, avec leurs “yeux neufs”, les aident à faire évoluer leur organisation -transversale et verticale-, à comprendre les besoins essentiels des salariés -levier de leur mobilisation-, à structurer les process de l’entreprise.
Comme le directeur marketing, le manager organisation à temps partagé intervient un à trois jours par semaine, sur une durée de quelques semaines ou mois. Son intervention étant temporaire, il peut aussi quelquefois “porter” les décisions difficiles… .
Managers à temps partagé, une solution souple et accessible pour accélérer le business des entreprises.
L’intérêt de solliciter un contrôleur des coûts
17 juillet 2025Commençons par une illustration de l’activité d’un Chef de Projet Evénementiel.
Un extrait du très bon livre « Just Whaou ! » de Christophe Pascal et Olivier Turco aux éditions Bréal.
…/…
Un événement exige la prise en compte d’une multitude de paramètres, de nature différente, de naviguer avec aisance et volupté dans une palette infime de domaines divers et variés : l’expression orale et écrite, la vente, la communication, la comptabilité et la production, le juridique, la logistique, la régie, la gastronomie et l’œnologie, la restauration et ses services, la décoration, la mode, le design, l’architecture d’intérieur, la mise en scène, la lumière, le son, l’Image, les nouvelles technologies, la direction de comédiens ou d’animateurs, …, et maîtriser de manière innée et précise leurs pratiques et leurs codes, leur terminologie et leurs usages, tout en étant au courant des toutes dernières tendances, des nouveaux lieux à la mode, buzz et autres rumeurs….
…/…
Le tout, et toujours, le pied sur l’accélérateur à 200 km/h dans une descente.
…/…
Dans le contexte actuel d’annonceurs qui n’ont pas toujours les idées précises des messages qu’ils souhaitent dégager, ni sur les cibles auxquelles ils veulent d’adresser.
Alors ?
Alors, entre cahier des charges pas toujours bien cadré (quand il existe), une Direction Générale qui a ses exigences -quelquefois contradictoires-, la pression d’une Direction des Achats pour qui ce sera de toutes façons trop cher et le Contrôle de Gestion qui entend limiter les dépenses, le Chef de Projet événementiel d’un annonceur -souvent jeune et pas toujours expérimenté- va devoir conjuguer des talents et apprendre à ménager les susceptibilités.
Avant d’arriver au bord de l’implosion, il y a une solution. Solliciter une expertise reconnue dans le métier, qui saura conseiller et guider les acteurs vers les prestations au plus pertinent et au juste prix, dans le respect de la qualité attendue, des délais imposés par le planning et d’une durabilité cohérente avec les valeurs de l’entreprise.
Quelques illustrations :
Un effet whaou vu des participants ne nécessite pas nécessairement le formidable concept technologique coûteux défendu par le Directeur de Création ou le Scénographe.
La rémunération des métiers intervenant est normale, mais il est mieux de bien en connaitre les règles et les usages.
Il en va de même pour les matériels loués ou achetés. Entre taux de remise et coefficient de durée, et qui ne sont pas les mêmes dans toutes les activités, on peut vite perdre pied, ou …payer cher une prestation !
Certes, tout se discute. Mais c’est plus facile de se comprendre en parlant la même langue.
Il est donc prudent d’associer une fonction de conseil et contrôle des coûts auprès du Chef de Projet événementiel.
Dès la construction du cahier des charges, il va poser les bonnes questions et s’assurer que les éléments sont complets et pertinents, pour éviter les incompréhensions « justifiants » ensuite des suppléments. Il va aider à cadrer le projet.
Il a des process et des outils d’analyse pour évaluer les retours agences et prestataires, au bénéfice de l’équipe projet, mais aussi au bénéfice de l’agence et des prestataires (on a déjà vu des oublis involontaires dans un devis).
Il va négocier les propositions, seul ou en concertation avec les métiers internes de l’entreprise (Direction des Achats par exemple). Il a un solide réseau d’agences et prestataires. Par sa pratique et ses référentiels de prix, il connait les coûts et a le réseau pour trouver ce qu’il cherche.
Il intervient dans le suivi de production et s’assure que les prestations vendues sont bien présentes sur le terrain.
Il dresse le bilan et rédige des recommandations (mini audit de fin de projet) qui sont appréciés des fonctions contrôle de gestion.
Et son coût est très largement amorti : son ROI se situe entre 3 et 30…
Les recruteurs prévoient d’avoir de plus en plus recours aux travailleurs indépendants
5 mai 2025Extrait www.francetvinfo.fr
Une nouvelle étude montre que le recours aux travailleurs indépendants par les entreprises est en train de gagner du terrain en France.
La « gig économy » est l’économie du travail à la tâche, fourni par des travailleurs indépendants, extérieurs à l’entreprise. Une nouvelle étude montre que ce mode de fonctionnement est en train de gagner du terrain en France.
Pratiquement un professionnel du recrutement sur deux envisage d’augmenter dans les années à venir le nombre de travailleurs indépendants qui fournissent des services à leur entreprise. C’est une étude du cabinet de conseil Kom Ferry qui met cette tendance en évidence. De quels travailleurs indépendants parle-t-on ? Des experts. Les nouvelles technologies ont rendu le monde du travail plus complexe. On a de plus en plus besoin de spécialistes très pointus. Les entreprises, plutôt que de les former en interne, préfèrent de plus en plus s’attacher leurs services le temps d’une mission. Ce sont eux dont le nombre devrait s’accroître dans les prochaines années. C’est ça, la « gig economy ».
Les entreprises y trouvent des avantages.
Le coût d’abord, bien sûr, même si le recours à un travailleur indépendant peut sembler plus coûteux, à l’heure. Une récente étude montrait qu’en France, un consultant facture ≈1 050€ sa journée. Mais les professionnels du recrutement interrogés estiment qu’au final, parce que les experts extérieurs à l’entreprise sont plus performants, ils finissent par permettre de réaliser des économies de fonctionnement.
Autre grand avantage pointé par les recruteurs : les consultants extérieurs sont plus faciles à manager que les troupes en interne. Ils auraient même, pour six recruteurs sur dix, un impact positif sur la culture de l’entreprise. Pourquoi ? Parce qu’ils apportent de l’extérieur de nouvelles façons de faire. Ils travaillent avec des clients divers. Ils peuvent donc inspirer les travailleurs de l’entreprise à laquelle ils louent leurs services. Ils deviennent si précieux qu’il faut tout faire pour les retenir. C’est en train de devenir un souci pour les entreprises fortement consommatrices de consultants extérieurs. Il faut les fidéliser. Les empêcher de partir à la concurrence. D’où l’arrivée, en interne, du chief freelance officer. Il est chargé de recruter, et surtout de chouchouter, les meilleurs consultants. Clairement, pour tous ceux qui ont une expertise pointue, il est en train de devenir plus intéressant de vendre ses compétences au plus offrant plutôt que de rester attaché à la même entreprise.
Pour une clarification des rôles entre clients et agence
12 mars 2025A côté du rôle de maître d’ouvrage côté client et de maître d’œuvre côté agence, n’oublions pas l’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui doit être assumée et valorisée de part et d’autre.
Les clients, qui dans l’industrie de la communication sont communément catalogué d’annonceurs (appellation désuète et réductrice par rapport l’activité de pilotage des marques, institutionnelles ou commerciales), et les agences passent du temps, seuls ou dans différences instances, à réfléchir à la gestion de leur relation: type de prestation, niveau de rémunération…
Etant client et ayant été en agence, je me demande si chacun est toujours bien conscient de son rôle. Je me demande même si pour plus de clarification, il ne serait pas nécessaire de se référer à des notions «universelles» utilisées dans des métiers connexes, qui font appel à des logiques projets similaires, comme dans l’architecture, l’informatique…
Parlons donc de maîtrise d’ouvrage, de cahier des charges, de maîtrise d’œuvre, sans oublier l’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui est sans doute le nœud gordien de la relation. Et voyons à qui attribuer les rôles entre le client et l’agence.
Maître d’ouvrage et maître d’oeuvre
Le maître d’ouvrage décrit les besoins, précise les objectifs, les délais et le budget alloué dans le cadre d’un cahier des charges rédigé. L’ouvrage, c’est «l’objet» livré à la fin du projet. Dans notre métier, le client est le maître d’ouvrage. L’expression des besoins est donc faite par le client. C’est ce qu’on appelle communément le brief, appellation à mon sens généralement réductrice aussi, par rapport à la nature des projets, qui nécessite un cahier des charges «engagé». Est-ce que le client remplit tout son devoir de maître d’ouvrage au moment de ce transfert de responsabilité vers l’agence? C’est à chacun de voir.
Le maître d’œuvre assure quant à lui la production du projet dans le respect des délais, du budget et de la qualité attendue. Pas de doute non plus, c’est le rôle de l’agence. Là où ça se complique, c’est la «zone grise» de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Celle-ci a pour mission d’aider le maître d’ouvrage à définir le projet réalisé par le maître d’œuvre. L’assistant a un rôle de conseil et de proposition, le décideur restant le maître d’ouvrage. En l’occurrence, il est fréquent pour un client de faire appel à de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, mais parfois sans le savoir ou sans le dire…
C’est un rôle à part entière qui peut être confié à un tiers, consultant indépendant ou cabinet de conseil, rémunéré comme tel. L’agence peut évidemment assumer ce rôle, ce qu’elle fait souvent, mais parfois sans le savoir ou sans le dire. Le risque est donc que l’assistance à maîtrise d’ouvrage s’installe par défaut ou par excès. Par défaut du rôle du client dans l’expression de son besoin. Par excès du rôle de conseil de l’agence.
Rémunération de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
Là où ça pêche dans la relation entre le client et l’agence, c’est en ce qui concerne la rémunération de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Celle-ci est nécessaire au client dans certain cas pour préciser le cahier des charges, ainsi qu’à l’agence pour produire le projet.
Il y a donc deux rôles principaux dans notre métier comme dans beaucoup d’autres: le client comme maître d’ouvrage et l’agence comme maître d’œuvre. Mais n’oublions pas le troisième: l’assistance à maîtrise d’ouvrage, parce que c’est bien le nœud gordien. Sachons de part et d’autre l’assumer et le valoriser quand il est nécessaire, pour clarifier la relation, que ce soit le type de prestation ou le niveau de rémunération.
L’événementiel responsable, aussi…
23 janvier 2025Tous les évènements sont concernés par la réduction de ses impacts environnementaux. Une première analyse des enjeux et objectifs de l’événementiel responsable permet d’identifier les avantages d’une telle démarche. La notion d’événement comporte de multiples facettes :
- le type de manifestation : forum, festival, événement sportif, lancement de produit, congrès, convention interne, exposition…,
- les publics : consommateurs, usagers, clients, distributeurs, fournisseurs, salariés, mais aussi riverains…,
- les objectifs de communication : informer, fédérer, surprendre, séduire, convaincre…,
Plus qu’un média de communication, l’événementiel accompagne les entreprises, les communautés d’acteurs et les territoires dans leur développement, leur socialisation et leur attractivité. Pour autant, cet incontournable fédérateur doit être acceptable par ses participants et la société, notamment du fait de l’impact environnemental du rassemblement. Car organiser un événement responsable va bien au-delà du tri et de la gestion des déchets et apporte de nombreux atouts :
- en termes d’image : le public se déplace plus volontiers sur une manifestation propre, engagée, respectueuse et responsable,
- en termes de service au public : gobelets réutilisables, restauration de qualité avec produits locaux, site propre…,
- en termes d’organisation, qui sera plus bénéfique par l’amélioration de l’existant pour le rendre plus efficace,
- en termes de valorisation auprès des participants …mais aussi des partenaires financiers.
Initier ce type de démarche permet aussi d’ouvrir vers de nouveaux réseaux et de travailler en partenariat avec des producteurs locaux, des services publics (collecte de déchets, prêt de matériel…), mais également des structures angagés dans la même démarche.
Il y a donc beaucoup à gagner en agissant pour limiter ces impacts. Le seul transport des personnes et la logistique pèsent près de 80% de l’impact carbone d’un événement… En moyenne, une manifestation qui rassemble 1 000 personnes peut consommer :
- 100 kg de papier, soient 2 arbres, 30 000 litres d’eau,
- 200 KWh d’énergie, soient 3 ans d’éclairage avec une ampoule économique de 15W,
- 500 kg de déchets soit environ la production d’un français en un an,
Action, donc.

